Bret Easton Ellis a 20 ans lorsqu’il publie Moins que Zéro en 1985, portrait désenchanteur d’une jeunesse aux corps perforés par les diktats de la société de consommation. 25 ans après, avec Suite(s) impériale(s), ses personnages se retrouvent pour une balade morbide et paranoïde dans un Los Angeles en clair obscur. Une ellipse magistrale qui règle leur compte aux adolescents de la génération X.
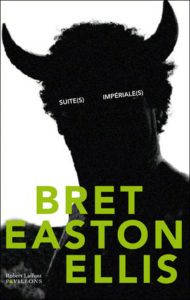
Moins que zéro s’achevait sur ces mots définitifs : « Des images si violentes et perverses que pendant très longtemps elles semblèrent être mon seul point de repère. » Un quart de siècle après, le point de repère de Clay n’a pas changé. Il revient à Los Angeles pour superviser l’adaptation au cinéma d’un de ses scénarios. Il y retrouve ses amis (à peine entrevus en vingt-cinq ans, lors d’une avant-première d’un film consacré à leur histoire) : Trent Burroughs, désormais producteur, a épousé Blair, son ex-grand amour ; Rip Millar, dealer d’antan au visage déformé par la chirurgie esthétique, mouille toujours dans des plans glauques ; quant à Julian Wells, compagnon de défonce et prostitué juvénile, il baguenaude dans un trafic de call girls. Surtout, Clay s’amourache de Rain Turner, une actrice de seconde zone incapable de jouer la comédie ailleurs que dans la réalité. Dans son sillage, le cauchemar commence…
Les retrouvailles avec ses (anti)héros de jeunesse constituent pour Bret Easton Ellis une histoire qui « répète les vieilles poses, les réponses désinvoltes, les mêmes défaites… », comme le chante Elvis Costello dans Beyond Belief, paroles reprises en exergue de Suite(s) impériale(s) (dont le titre original Imperial Bedrooms est également tiré d’un de ses albums). À 45 ans, il les plonge dans un monde d’adultes de plus en plus tourné vers une sauvagerie assassine et radicale. Il en a donc définitivement fini avec l’insouciance pubère qui n’a jamais été pour ses personnages une sinécure, mais une fuite en avant tournée vers des dérivatifs protéiformes afin de meubler l’ennui d’une époque rompue au vide, au superficiel, à la société de surconsommation. Rien d’étonnant donc à ce qu’arrivés à maturité, ils continuent de sniffer de la coke, d’enchaîner les baises avec « des filles nerveuses et sexuellement faciles», de s’exhiber au volant de splendides voitures. Mais la société a évolué en pire : les vidéos à la minute de Youtube ont remplacé les snuff movies de Moins que Zéro, les maîtres-chanteurs balancent désormais des SMS chargés de menaces et derrière les vitres des appartements de plus en plus dépouillés, des ombres attendent le moment opportun pour se manifester et avouer leurs secrets glaçants. Au pays de l’écran roi, le reflet dans le miroir est devenu borgne.
Faux semblants et trompe-l’œil

À la manière de Raymond Chandler qu’il admire, Bret Easton Ellis construit Suite(s) impériale(s) comme un polar des années 40 : une femme fatale sonne le déclin de personnages complexes et ambigus au passé trouble. Comme dans ses œuvres précédentes, d’American Psycho à Lunar Park en passant par Glamorama, le talent de l’auteur américain réside dans son aptitude à trouver le point d’implosion du genre humain pour le clouer au pilori de ses travers sordides. À la faveur d’un style à la première personne, toujours névrotique, minimaliste et descriptif, dans une cité des anges mythologique qui rend fou (oscillant entre le Mulholland Drive fantasmé de David Lynch et la vision corruptrice et toxique de L.A. Confidential de James Ellroy). Univers urbain superficiel (villas de luxe, collusions d’intérêts financiers, trafics de stupéfiants et de filles) où le diable rôde la gueule ouverte.
Dans une scène de torture désertique et sauvage, un couple franchit les limites de la violence. Les victimes deviennent alors des bourreaux en puissance « parce qu’ils ont tenté de situer le moment où ils étaient morts intérieurement ». Mourir à feu vif lors du sacre de la jeunesse ou exploser « telle une bannière étoilée » sur l’autel de l’âge adulte, le résultat demeure le même. Bret Easton Ellis est souvent taxé de moraliste. Cependant, vingt-cinq ans après, ses personnages ont toujours le trouillomètre au ventre faute de parvenir à s’aimer, ainsi qu’en témoignent les dernières lignes splendides de ces suites froidement impériales !







