Chargé de cours à l’Université Paris 1, Jean-Claude Wallach est l’auteur de La Culture, pour qui ?, un petit livre iconoclaste et controversé qui remet en cause quarante ans de politiques culturelles. Loin d’être subversif, Wallach appelle avant tout les acteurs culturels à repenser leurs rapports avec la population.
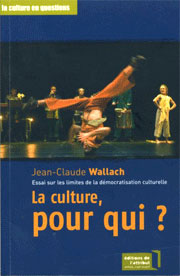
La Griffe : Pourquoi les politiques publiques de la culture doivent-elles être reconstruites ?
Jean-Claude Wallach : Globalement, elles ont eu du mal à atteindre les objectifs qui les ont légitimées. Prenez la démocratisation culturelle. Son véritable enjeu était de changer la structure des publics, de faire en sorte que les gens les plus éloignés de la culture se trouvent concernés. Mais on voit toujours les mêmes dans les salles de spectacle. Les statistiques montrent bien que la diversification ne fonctionne pas. Pour autant, je ne porte pas un jugement de valeur sur ce que les acteurs culturels font individuellement pour que ça change.
La démocratisation culturelle n’est-elle pas un leurre ?
Transformer la structure sociale des publics n’est pas impossible. Il faut regarder quelle relation chacun entretient avec l’activité culturelle. Puis il faut jouer sur le sens de cette relation pour amener progressivement les individus vers des formes nouvelles, tout en leur permettant de construire leur propre rapport à ces formes. Il y a une anecdote qui illustre cela. Dans les années 70, le comité d’entreprise d’une société organisait des sorties pour amener ses ouvriers voir des spectacles. Cela marchait très bien. Quelques années plus tard, pour faire des économies, on enlève les autocars et ça ne fonctionne plus. Qu’est ce qu’on a oublié ? Que les travailleurs de l’entreprise, réunis par l’action syndicale, venaient ensemble dans un lieu dont ils pouvaient se sentir exclus, mais l’autocar leur permettait d’assumer collectivement cela.
Aujourd’hui certains ont pris conscience de la nécessité de s’adresser différemment au public. Prenez le texte de François Bon mis en scène par Charles Tordjman sur la fermeture de l’usine Daewoo en Lorraine. Grâce à un travail d’élaboration collectif, de recueil de mémoire, de participation des amateurs… ils construisent un autre rapport avec les individus et sortent de la relation habituelle de la diffusion des spectacles. Du coup on constate que cela a des effets sur la composition des publics. C’est l’œuvre qui fabrique le public.
Pourquoi a-t-on privilégié la place des artistes dans notre système culturel au détriment de l’accès des populations ?
C’est une question complexe. Je ne pense pas que le ministère de la Culture se soit donné comme objectif l’accomplissement des publics. Il a d’abord et avant tout fonctionné comme un ministère de la création. À cause d’intérêts importants, tout le monde a voulu accréditer l’idée qu’il suffisait d’augmenter l’offre pour qu’elle se démocratise. Or les sociologues ont vite démontré que proximité spatiale et proximité sociale ne fonctionnaient pas de la même façon et qu’il ne suffisait pas de bâtir des équipements culturels pour que les gens entrent dedans. Ce qui est sûr, c’est que la consommation a augmenté. Ceux qui fréquentaient déjà les lieux culturels y sont allés plus souvent.
Dans les années 60, il y a eu une volonté de moderniser la société française. Le politique s’est dit que l’artiste pouvait l’accompagner dans cette tâche et l’artiste a trouvé cela utile parce que ça lui permettait de trouver un moyen de légitimation sociale, pas seulement en terme budgétaire. En y réfléchissant bien on parle de la relation de Louis XIV et de Molière, lequel par son regard critique sur une petite bourgeoisie montante a aussi servi les intérêts du Roi.
L’artiste associé à un lieu, est-ce la même relation ?
Doit-on confier les établissements à des artistes ou à des intendants comme on dit en Allemagne ? À cette question, qui n’a jamais été résolue, il y en a une autre qui se superpose : comment accompagner les artistes et leur donner les moyens de produire ? En France, il y a une sorte de cursus honorum dans le spectacle vivant : d’abord vous ramez comme amateur avant de devenir professionnel. On ne sait pas quand d’ailleurs, probablement quand vous remplissez les critères de l’intermittence. Ensuite les premières subventions de l’État arrivent. Si vous vous débrouillez bien vous avez une convention de trois ans, puis un petit centre dramatique, puis on vous en donne un plus gros… Le problème de ce système est qu’il n’est pas très pertinent au regard des parcours, tout n’est pas si linéaire. De plus, il y a tellement de gens engagés dans ce processus qu’il n’y a pas de place pour tout le monde. Donc il faut aider les artistes différemment dans leur évolution. Avoir des accueils en résidence de moyenne ou de longue durée, plusieurs artistes associés à la direction d’un établissement sont des idées à creuser. Peut-être qu’en élargissant les modalités de gestion de tout ça on pourra accompagner plus de gens. C’est une question de politique artistique, pas de politique culturelle. Pour reprendre la définition d’un ami : « L’art c’est la chose et la culture c’est la relation à la chose. » C’est le rapport que nous entretenons, à la fois individuellement et collectivement, avec toutes les formes d’expressions symboliques. La politique culturelle concerne la relation à l’œuvre. C’est donc stupide de légitimer la défense des artistes, qui est une responsabilité publique, par le coût de la démocratisation.
Qui doit faire l’articulation entre l’œuvre et le public : les artistes, les médiateurs culturels, l’école… ?
Elle doit mobiliser tout le monde, c’est ça qui est complexe. L’approche de Malraux, quand il explique le miracle qui s’accomplit lorsque l’individu est confronté à l’œuvre, a ceci de juste qu’elle renvoie au sensible. Mais si on reste dans l’émotionnel face à un tableau de Picasso, sans transmission des codes, de l’histoire de l’art… on va avoir des réactions du style : « Mon gosse y fait la même chose ! » La médiation est essentielle, mais il faut que chacun reste à sa place.
Votre livre a fait très peu de bruit lors de sa sortie malgré ses postulats. Ça a été tout le contraire lorsque vous avez été nommé délégué du Syndeac [Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles], puisque vous avez été poussé à la démission. Comment l’expliquez-vous ?
La situation a explosé quand des membres de ce syndicat ont pensé que mon arrivée mettait en danger leur positionnement et leur place. Ce qui n’a rien arrangé, c’est que tout ça coïncidait avec la candidature de Sarkozy et le discours de l’UMP qui parlait de l’échec de la démocratisation culturelle. Un membre du Syndeac m’a dit : « Un des problèmes de ton bouquin, c’est que Sarkozy raconte les même trucs que toi. » Du coup dans la profession, ça a été l’inverse, c’est moi qui parlais comme lui.
Vouloir renouveler la politique culturelle d’un pays à l’heure où les industries culturelles sont en passe d’accomplir le rêve de Malraux, cela a-t-il un sens ?
Ce ne sont pas les industries qui posent problème, c’est le fait que nous sommes dans une période de remise en cause générale, à droite comme à gauche, de la place de la régulation publique dans la société. C’est pour ça que l’idée de refonder les politiques culturelles est folle. Contrairement à la Charte des missions de service public de Catherine Trautmann, qui formalisait les raisons pour lesquelles l’État mettait de l’argent quelque part et les responsabilités que devaient assumer les bénéficiaires, la Lettre que Sarkozy a adressée à la ministre de la Culture Christine Albanel est une feuille de route de démantèlement. Cette position est dangereuse parce qu’elle désengage l’État des territoires. Les collectivités vont avoir un mal de chien à assumer cela. Les régions vont entrer en concurrence, les inégalités vont se creuser.
Les aides financières aux artistes sont de plus en plus souvent conditionnées par des interventions sociales, qu’en pensez vous ?
Celui qui bénéficie de l’argent public a une responsabilité sociale. Dans beaucoup de situations difficiles, l’intervention de l’artiste peut être un apport, pas forcément pour régler les problèmes sociaux mais pour permettre de les verbaliser, ce qui est déjà une avancée. Je suis assez partisan de structurer l’appel au volontariat, mais je condamne l’injonction. D’ailleurs pourquoi y a-t-il cette injonction ? Parce que les politiques culpabilisent de financer l’art sans contrepartie, c’est le vieux débat de la légitimité de la dépense publique. Est ce qu’on culpabilise quand on est dans un rapport marchand ? Non.







